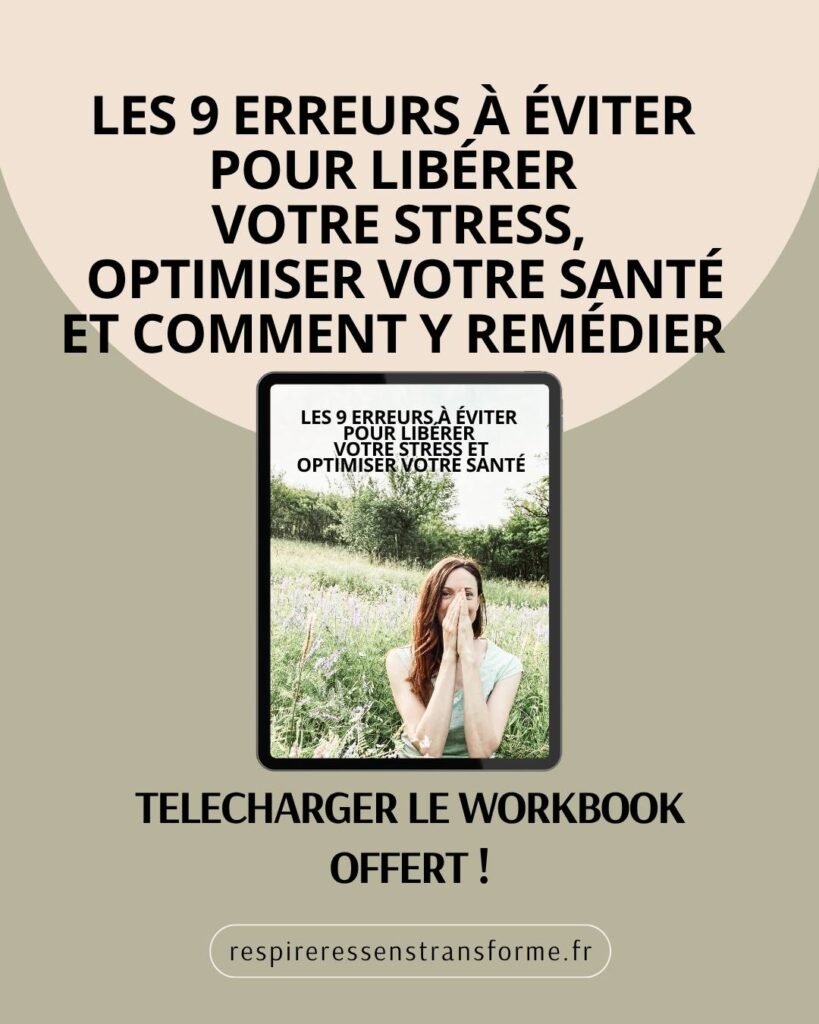Le journaling n’est pas qu’un loisir romantique avec un carnet et un stylo : c’est un outil thérapeutique, cognitif et comportemental qui permet d’éclairer ce qui se passe à l’intérieur, d’identifier les freins et d’orienter la vie vers ce qui compte vraiment.
Avant de commencer : si tu as vécu des traumatismes profonds, certaines écritures expressives peuvent réveiller des émotions intenses. Avance avec bienveillance et, si besoin, avec le soutien d’un professionnel (thérapeute, psychologue). Je fournis aussi des alternatives plus douces.
Croyances limitantes — repérer, désacraliser, dépasser
Pourquoi travailler les croyances limitantes ?
Les croyances (je suis trop vieux·vieille, je ne mérite pas, je ne suis pas capable) orientent nos choix, nos émotions et nos actions. Les identifier par écrit permet d’externaliser ce qui est pris pour « vérité », de l’examiner à distance et de le reformuler. C’est une technique de cognitive-restructuration proche de la thérapie cognitive mais très accessible en auto-accompagnement.
Des protocoles d’écriture introspective (expressive writing) ont montré qu’écrire sur ses émotions et sur des événements importants peut améliorer le bien-être psychologique et parfois même la santé physique. La recherche qui a commencé avec Pennebaker montre des effets durables, et des meta-analyses confirment une efficacité modeste mais fiable quand la méthode est bien conduite.
Objectifs de l’exercice
-
Mettre en lumière les croyances qui te freinent.
-
Les désacraliser (les rendre « juste » des pensées, pas des vérités immuables).
-
Construire des affirmations alternatives et des actions concrètes pour tester leur validité.
Durée & fréquence
-
10–20 minutes, 2 à 3 fois par semaine au début, puis une fois par semaine en entretien.
-
Variante courte : 5 minutes chaque matin pour repérer la croyance qui apparaît dans la journée.
Méthode pas à pas
-
Installe-toi 10 minutes au calme (musique douce si tu veux).
-
Écris le titre : « Croyances qui me freinent ».
-
Liste librement (bullet points) toutes les croyances qui te viennent à l’esprit. N’édite pas, écris tout. Exemple : *« Je n’ai pas le temps », « Je ne suis pas créative », « Je mérite rarement du repos ». *
-
Pour chaque croyance, note :
-
Origine possible (souvenir, remarque entendue, situation).
-
Preuves pour (ce qui t’amène à le croire).
-
Preuves contre (moments où ce n’était pas vrai).
-
-
Désacralisation : écris une phrase courte qui montre que c’est une pensée, pas une vérité absolue — ex. « Parfois je manque de temps, mais cela ne veut pas dire que je ne peux jamais m’organiser différemment ».
-
Crée une expérimentation (action) pour tester la croyance pendant 7 jours : ex. si la croyance est « je n’ai pas le temps », test : « chaque matin, 15 minutes pour moi, notées dans l’agenda ».
-
À la fin de la semaine, écris ce que tu as observé : résistances, surprises, micro-succès.
Inspirations
-
« Une croyance que j’entends souvent dans ma tête et qui me freine est : ___ »
-
« Cette croyance m’est utile (oui/non) parce que : ___ »
-
« Une preuve qui contredit cette croyance : ___ »
-
« Si je traçais un petit pas pour la tester cette semaine, ce serait : ___ »
Outils/conseils pratiques
-
Utilise 3 colonnes sur une double page : Croyance / Origine & Preuves / Expérimentation.
-
Colle un post-it sur ton miroir avec l’affirmation alternative choisie.
-
Mesure : note chaque jour (oui/non) si tu as réalisé l’expérimentation — petit tracking visuel aide à la confiance.
-
Application utile : un simple document (Google Docs) ou un cahier A5. Si tu veux une app, Day One ou Journey font bien l’affaire.
Variante pour enfants (6 ans)
-
Jeu : « chasse aux pensées » — dessiner une pensée-monstre et lui donner un nom. Ensuite, imaginer un super-héros (affirmation) qui réduit le monstre.
Gratitude — amplifier ce qui nourrit
Pourquoi la gratitude ?
Des études expérimentales montrent que tenir un carnet de gratitude (lister, régulièrement, des choses pour lesquelles on est reconnaissant·e) augmente l’humeur, le bien-être subjectif et peut même avoir des effets physiques (meilleur sommeil, moins de visites médicales dans certains cas). L’étude classique d’Emmons & McCullough (2003) a montré que les participants qui notaient leurs « bénédictions » ressentaient plus de bien-être et moins de symptômes que ceux qui notaient les tracas.
Objectifs de l’exercice
-
Développer l’attention aux ressources (internes et externes).
-
Contrer le biais de négativité en cultivant l’habitude de remarquer le positif.
-
Augmenter la résilience émotionnelle.
Durée & fréquence
-
5–10 minutes par jour, idéal le soir avant de dormir ou le matin.
-
Même 3 fois par semaine a des effets.
Méthode pas à pas
-
Choisis ton moment (matin pour orienter la journée / soir pour clore la journée).
-
Titre : « 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant·e aujourd’hui ».
-
Écris trois éléments, et détaille pourquoi chacun compte. Ne te contente pas de mots : cherche l’émotion ou la petite raison précise. Exemple : « Un thé chaud à 8h — parce que j’ai pris un moment pour moi et j’ai senti ma mâchoire se relâcher. »
-
Ajoute une ligne : « Comment je peux nourrir cela demain ? » (action minuscule).
Prompts prêts à l’emploi
-
« Aujourd’hui, j’ai aimé ___ parce que ___ »
-
« Une personne qui a été présente pour moi cette semaine : ___ (comment lui dire merci ?) »
-
« Quelle petite chose m’a fait sourire aujourd’hui ? »
Outils/conseils pratiques
-
Fleurir le rituel : une bougie, un marque-page joli, un signe de fin de journée.
-
Varier : gratitude pour le corps, pour les relations, pour des compétences développées.
-
Pour les jours difficiles : note simplement « j’ai survécu à aujourd’hui » comme un point de gratitude — la pratique s’adapte à la réalité.
Limites et bonnes pratiques
-
Ne pas forcer une gratitude artificielle si tu traverses un deuil ou une dépression sévère ; dans ces cas, la gratitude peut être intégrée plus doucement (reconnaissance pour la respiration, avoir de l’eau chaude, etc).
Météo intérieure — état présent et regard bienveillant
Pourquoi prendre la « météo intérieure » ?
Être capable d’étiqueter notre état émotionnel augmente la régulation émotionnelle. La mise en mots des émotions (affect labeling) réduit l’intensité émotionnelle et facilite la prise de décision consciente. Noter régulièrement son état permet de repérer des patterns (jours, situations, signes précurseurs) et d’intervenir plus tôt. (La recherche sur l’affect labeling et sur la mindfulness montre qu’étiqueter les émotions aide à leur modulation.)
Objectifs de l’exercice
-
Prendre le pouls de soi, sans jugement.
-
Détecter les tendances (fatigue chronique, irritabilité, moments de clarté).
-
Déclencher ensuite une stratégie courte d’auto-régulation (respiration, pause, action).
Durée & fréquence
-
1–5 minutes, idéalement matin, midi, soir (mini-check).
-
Un check plus approfondi (10–15 min) une fois par semaine pour relire les tendances.
Méthode pas à pas
-
Crée un tableau simple : Date / Heure / Intensité (1–10) / État (ex. calme, anxieux, fatigué, joyeux) / Besoin immédiat.
-
À la première colonne, note l’état en mots (pas de jugement).
-
Ajoute une courte action pour répondre au besoin (ex. « besoin = oxygène ; action = 3 minutes de respiration 4-4 »).
-
À la fin de la semaine, relis : quels patterns ? À quel moment de la journée l’anxiété monte-t-elle ?
Echelles utiles
-
Échelle d’intensité : 1 = paisible / 10 = submergé.
-
Prompt : « En ce moment, mon corps ressent ___ ; mes pensées disent ___ ; ce dont j’ai besoin est ___ ».
-
Variante corporelle : scanne ton corps du sommet du crâne jusqu’aux pieds et note où tu sens de la tension.
Outils/conseils pratiques
-
Un tableau dans ton carnet ou une note sur le téléphone ; utilises des emojis si tu aimes le visuel.
-
Combiner avec des micro-pratiques : 3 respirations carrées, boire un verre d’eau, marcher 5 minutes.
-
Pour les enfants : météo avec images (soleil, nuage, pluie, orage) pour qu’ils désignent leur état.
Mon pourquoi — clarifier la motivation profonde
Pourquoi écrire son « pourquoi » ?
La clarté motive. Les recherches en psychologie de la motivation (théorie goal-setting) montrent que des objectifs clairs, acceptés et précis facilitent l’action et la persévérance. Travailler le « pourquoi » permet de relier une action à une valeur profonde, ce qui augmente l’engagement et l’endurance face aux obstacles.
Objectifs de l’exercice
-
Formuler une motivation profonde et personnelle pour un objectif.
-
Identifier les leviers émotionnels et pratiques qui te poussent à agir.
-
Transformer une intention vague en plan avec étapes.
Durée & fréquence
-
20–30 minutes pour une session complète.
-
Relecture mensuelle pour ajuster.
Méthode pas à pas (méthode WOOP intégrée)
Utilise la technique WOOP (Wish, Outcome, Obstacle, Plan) — une méthode de mental contrasting validée empiriquement pour améliorer la réalisation d’objectifs. WOOP t’aide à visualiser le souhait, imaginer le meilleur résultat, anticiper l’obstacle interne et définir un plan d’action concret.
-
W (Wish) : Quel est mon souhait concret, réalisable, mesurable ? (ex. « lancer un atelier mensuel »).
-
O (Outcome) : Quel serait le meilleur résultat si je réalise ce souhait ? Décris en sensations, bénéfices.
-
O (Obstacle) : Quel est l’obstacle intérieur principal (fausse croyance, peur, manque d’énergie) ? Sois honnête.
-
P (Plan) : Si (obstacle), alors je ferai (action). Ex. « Si je procrastine, alors je m’accorde 15 min et j’utilise la technique Pomodoro (15/5) ».
Inspirations :
-
« Mon objectif concret pour les 3 prochains mois est : ___ »
-
« Si je réussis, ce que je sentirai/ferai sera : ___ »
-
« L’obstacle intérieur le plus probable est : ___ »
-
« Plan d’action simple si l’obstacle se présente : ___ »
Outils/conseils pratiques
-
Transforme le « pourquoi » en micro-routines hebdomadaires (habit stacking).
-
Utilise un tableau SMART pour définir ton objectif (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporel).
-
Rappelle-toi : la motivation fluctue ; c’est le plan concret et les micro-habitudes qui portent le changement.
Mon rêve — décrire, détailler, donner de la matière au possible
Pourquoi écrire son rêve en détail ?
La visualisation structurée et l’écriture détaillée transforment une idée floue en projet concret. En décrivant ton rêve avec des sens, des acteurs, des émotions et des étapes, tu permets au cerveau de créer des associations, de repérer des opportunités et d’aligner tes actions quotidiennes vers sa réalisation. La recherche sur la visualisation, couplée aux mécanismes de WOOP et de fixation d’objectifs, montre que l’équilibre entre rêver et anticiper les obstacles (mental contrasting) est ce qui favorise l’action.
Objectifs de l’exercice
-
Rendre le rêve plus tangible.
-
Extraire des premières étapes pratico-pratiques.
-
Créer de l’émotion positive moteur d’action.
Durée & fréquence
-
20–40 minutes pour une première rédaction.
-
Relire et enrichir une fois par mois.
Méthode pas à pas
-
Titre : « Mon rêve : [titre court] ».
-
Décris le décor (où, quand, avec qui), les sensations (odeurs, sons), les couleurs, ton corps dans ce rêve. Utilise le présent pour dynamiser. Exemple : « Je me tiens sur la scène, je sens le bois chaud sous mes pieds, une lumière dorée sur le public… »
-
Raconte le déroulé : début / milieu / fin.
-
Note « pourquoi » ce rêve est important (valeurs touchées).
-
Liste 3 premières actions concrètes et réalistes (micro-étapes) à faire dans le mois pour avancer vers ce rêve.
Inspirations
-
« Si je pouvais vivre ce rêve dès demain, la première chose que je verrais serait : ___ »
-
« Qui m’accompagne dans ce rêve ? Que ressent-elle/il ? »
-
« Trois actions mini pour commencer à construire ce rêve : 1) ___ 2) ___ 3) ___ »
Outils/conseils pratiques
-
Crée un moodboard (images) qui accompagne le texte dans ton carnet.
-
Associe une musique-repère et écoute-la quand tu relis ce texte pour renforcer l’émotion.
-
Transforme une action en micro-habitude (ex. 10 minutes par jour sur une tâche liée au rêve).
Précautions et éthique personnelle
-
Si l’écriture réactive un trauma ancien, coupe l’exercice et pratique une technique d’ancrage (respiration, contact avec les pieds au sol, 5 sens) — et contacte un professionnel si nécessaire.
-
Respecte ton rythme : certaines journées demandent une écriture légère, d’autres une pause.
-
Confidentialité : si tu écris sur des personnes ou des faits sensibles, protège ton carnet ou utilise un mot de passe sur ton app.
Merci d’être présente ici, prenez soin de vous.
A bientôt
🌿 Respire Ressens Transforme : un accompagnement individuel et des ateliers collectifs pour apaiser votre système nerveux, améliorer votre quotidien, reprendre confiance en vous et harmonisez votre vie en s’alignant avec vos valeurs.
Nadine
Quelques études et revues pertinentes
-
Expressive writing & santé (Pennebaker) — travaux fondateurs montrant que l’écriture expressive sur des événements émotionnels améliore certains indicateurs de santé et bien-être. (Pennebaker, 1986 et articles ultérieurs). Faculté des Sciences Sociales et Humaines+1
-
Méta-analyse sur l’écriture expressive (Frattaroli, 2006) — revue quantitative de nombreux essais randomisés montrant un effet global positif, avec des modérateurs (type d’échantillon, durée, etc.). PubMed
-
Gratitude (Emmons & McCullough, 2003) — étude expérimentale « Counting Blessings vs Burdens » qui montre que tenir un carnet de gratitude accroît le bien-être subjectif. Greater Good
-
WOOP / mental contrasting (Oettingen) — la méthode WOOP (Wish, Outcome, Obstacle, Plan) est une stratégie basée sur la mental contrasting qui améliore la réalisation d’objectifs comparée au simple optimisme. WOOP my life+1
-
Goal-setting theory (Locke & Latham) — cadre théorique solide sur l’importance des objectifs clairs pour la performance et l’action. Massachusetts Institute of Technology
-
Revue sur les effets de l’écriture (Niles et al., 2013) — synthèse moderne sur l’écriture expressive et ses effets psychologiques et biomédicaux. PMC
-
Pennebaker — travaux sur l’écriture expressive (PDF introductif et articles) :
https://cssh.northeastern.edu/pandemic-teaching-initiative/wp-content/uploads/sites/43/2020/10/Pennebaker-Expressive-Writing-in-Psychological-Science.pdf Faculté des Sciences Sociales et Humaines -
Frattaroli J. (2006) Experimental disclosure and its moderators: a meta-analysis (PubMed) :
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17073523/ PubMed -
Emmons R.A., McCullough M.E. (2003) Counting Blessings Versus Burdens (PDF) :
https://greatergood.berkeley.edu/pdfs/GratitudePDFs/6Emmons-BlessingsBurdens.pdf Greater Good -
WOOP — site officiel (pratique et science) :
https://woopmylife.org/ WOOP my life -
Locke & Latham — A Theory of Goal Setting & Task Performance (chapitres/ressources) :
https://web.mit.edu/curhan/www/docs/Articles/15341_Readings/Motivation/Locke%20Theory%20of%20Goal%20Setting%20Ch%201-2.pdf Massachusetts Institute of Technology -
Niles et al. (2013) — revue sur les effets de l’écriture expressive (PMC) :
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3830620/ PMC